Comment donner une expressivité particulière à son propos ? Grâce aux figures de style, bien entendu ! Le théâtre, la poésie et la littérature en général regorgent de ces procédés d’écriture qui donnent du relief au récit. Cyrano de Bergerac en use, par exemple, lorsqu’il s’exclame à propos de son nez : « C’est un roc ! … c’est un pic ! … c’est un cap ! … Que dis-je, c’est un cap ? … c’est une péninsule ! » Il s’agit d’une auxèse : le héros affirme avec beaucoup d’hyperboles que oui, décidément, son nez est bien grand !

En français, il existe de nombreuses figures de style utilisées en fonction de l’idée que l’on souhaite exprimer (l’atténuation, l’insistance, l’opposition…). Tenter de leur donner une définition et de les classer est toujours délicat. Depuis des siècles, les linguistes s’y emploient.
L’objet de cet article est de proposer une présentation – la plus complète possible – des principales figures de style utilisées en français. Utile si vous préparez le bac… le brevet… ou si, tout simplement, vous vous intéressez à ces beaux procédés rhétoriques qui contribuent à la beauté du français ?. Vous souhaitez aller plus loin ? À la fin de cet article, vous trouverez un exercice que Projet Voltaire a préparé. Vous pourrez vous entraîner à reconnaître les figures de style !
Sommaire :
- Qu’est-ce qu’une figure de style ?
- Les principales figures de style
- Exercice autour des figures de style
C’est quoi, une figure de style ? Éléments de définition
Une figure de style est un procédé d’expression spécifique. Il consiste à amplifier son propos, à l’illustrer, à lui donner une sonorité particulière… La figure de style peut être mobilisée pour convaincre, ou plus simplement pour mettre en valeur un élément particulier dans le discours écrit ou oral. Elle contribue à la construction syntaxique.
On a dit plus haut que les figures de style étaient très présentes en littérature. C’est vrai, mais elles sont aussi beaucoup employées dans le registre courant, dans l’écriture journalistique, dans le langage sportif, etc.
Quand le capitaine Haddock traite son interlocuteur de « bachi-bouzouk », il utilise une figure de style spécifique, la métaphore. Les bachi-bouzouks, ces cavaliers mercenaires de l’Empire ottoman, étaient en effet connus pour terroriser les peuples conquis. Haddock dépeint son interlocuteur comme une sorte de barbare primaire.
De même, n’entend-on pas régulièrement ces expressions :
- « L’opposition tacle le gouvernement. »
- « Les français ont boudé les urnes. »
- « Matignon refuse de s’exprimer. »
- « La rue ne gouverne pas. »
- « L’abstention est le premier parti de France. »
Quand vous dites que vous allez « boire un verre », il s’agit encore une fois d’une figure de style, car on ne boit pas littéralement un verre…
Chaque expression permet de bien comprendre le propos. C’est en quelques sorte une manière imagée de dire ce que l’on veut, de faire passer un message ou une information. Maintenant passons aux choses sérieuses, et présentons les figures de style ! Musique, maestro ! (Oh ! encore une figure de style !)
Une liste des principales figures de style en français
Les figures de style d’opposition
L’antiphrase
Très employée, souvent par ironie, l’antiphrase consiste à utiliser une phrase contraire à la signification première. Il y a donc ici un écart que le destinataire du message doit mesurer.
- Mais que c’est drôle ça ! (alors que ce n’est pas drôle du tout)
- Eh bien ! c’est malin ! (alors que c’est stupide)
- Toujours à l’heure, celui-ci ! (alors qu’il est fréquemment en retard)
Notez que l’antiphrase peut également être classée dans les figures d’atténuation.
L’antithèse
Cette figure de style consiste à rapprocher deux mots, groupes de mots ou expressions de sens opposé, ou antonymes au sein d’une phrase. Cela permet de créer un fort contraste. L’un des exemples les plus célèbres est la tirade écrite par Corneille dans Le Cid : « À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire ».
On notera l’habile détournement de cette réplique par Goscinny dans Astérix chez les Bretons : « À vaincre sans péril, on évite les ennuis ! » Du reste, Astérix et Obélix sont, à leur manière, des antithèses.

Le chiasme
Que voilà une jolie figure de style ! Celle-ci consiste à « croiser » ou opposer deux éléments au sein d’une même phrase. Molière, dans l’Avare, utilise le chiasme lorsqu’il fait dire à l’un de ses personnages : « Il faut manger pour vivre et non vivre pour manger. » Cela permet d’établir une symétrie entre ces deux éléments…
L’ironie
Voilà une bien célèbre figure de style… à moins qu’il s’agisse d’un effet ? Sur ce point, les linguistes sont divisés. Contentons-nous de préciser que l’ironie permet de dire autre chose que ce que l’on veut réellement dire… tout en sachant que le destinataire comprendra parfaitement. L’antiphrase, vue plus haut, est une des formes que peut prendre l’ironie.
- C’est intelligent ce que tu viens de dire ! (On comprendra dans le contexte que c’est au contraire stupide.)
Toutefois, l’ironie peut prendre d’autres formes, l’objectif étant toujours que le message principal soit bien compris malgré la dissimulation apparente. Exemples :
- Ce que tu viens de cuisiner n’a pas l’air mauvais… (On comprendra que ça a l’air très bon.)
- Luc et Adèle ? Ils sont dans l’une des chambres. Ils… jouent aux cartes. (On comprendra que Luc et Adèle s’emploient à une tout autre activité…)
L’oxymore
Il s’agit ici de rapprocher dans une expression deux mots ou groupes de mots ayant des significations opposées, afin de donner un effet de style à son expression : un silence assourdissant, une comédie tragique, une ombre lumineuse… La différence avec l’antithèse ou l’antiphrase est que l’oxymore « tient » généralement dans une expression, ainsi que le montrent les exemples précédents.
Le paradoxe
Proche de l’oxymore, le paradoxe consiste à rapprocher deux mots ayant des sens radicalement opposés. La différence entre ces deux figures de style réside dans le fait que le paradoxe va à l’encontre d’une vérité communément admise. Dans Don Camillo, Fernandel assure par exemple : « En politique, il faut parfois complexifier les choses pour les rendre plus simples. » Le paradoxe est souvent provocateur et presque toujours empreint de style et de clarté malgré la contradiction apparente.
Les figures de style d’atténuation ou d’omission
L’ellipse
Vous omettez volontairement un ou plusieurs éléments dans votre phrase ? Alors vous faites usage de l’ellipse ! Attention cependant : ni le sens ni la cohérence ne doivent s’en trouver affectés. Les mots qui restent permettent de faire toute la lumière sur ce que l’on veut dire. Exemple : « Je leur ai dit d’agir immédiatement. Simple question d’efficacité. »
Notons que, pour économiser les mots, les proverbes, les titres de presse et les slogans publicitaires reposent très souvent sur les ellipses. Par exemple : « Terrible tempête dans le sud du pays : 18 morts. »
L’euphémisme
Cette figure de style est connue, sans doute parce qu’elle est très utilisée. Il s’agit d’atténuer une idée en employant un mot ou une expression par un équivalent plus faible. L’objectif consiste souvent à ne pas déplaire ou à éviter de choquer. Exemples :
- « Cette dame d’un certain âge » permet d’éviter de dire : « Cette vieille dame ».
- « Il s’est éteint… » ou « Il nous a quittés… » permet d’éviter de dire : « Il est mort. ».
- « Il n’est pas très agréable… » permet d’éviter de dire : « Il est odieux. ».
La litote
L’une des plus célèbres litotes est sans doute cette réplique dans Le Cid de Corneille : « Va, je ne te hais point. » Le propos est affaibli afin de laisser entendre plus que ce que l’on dit. Ainsi, dans cet exemple, on devine que Chimène ne se contente pas de « ne pas haïr » Rodrigue. La litote est donc une atténuation. Le contexte permet de deviner le sentiment réel de la personne qui l’utilise. Elle peut parfois prendre la forme d’une double négation :
- Je ne suis pas incapable de faire face à cette situation (j’en suis tout à fait capable).
- Il n’est pas insensible à mes arguments (il y est sensible).
Autre exemple de litote, celle qu’emploie Victor Hugo dans son poème Veni, vidi, vixi : « J’ai bien assez vécu… » On comprendra ici que l’auteur dit à demi-mot qu’il attend la mort.
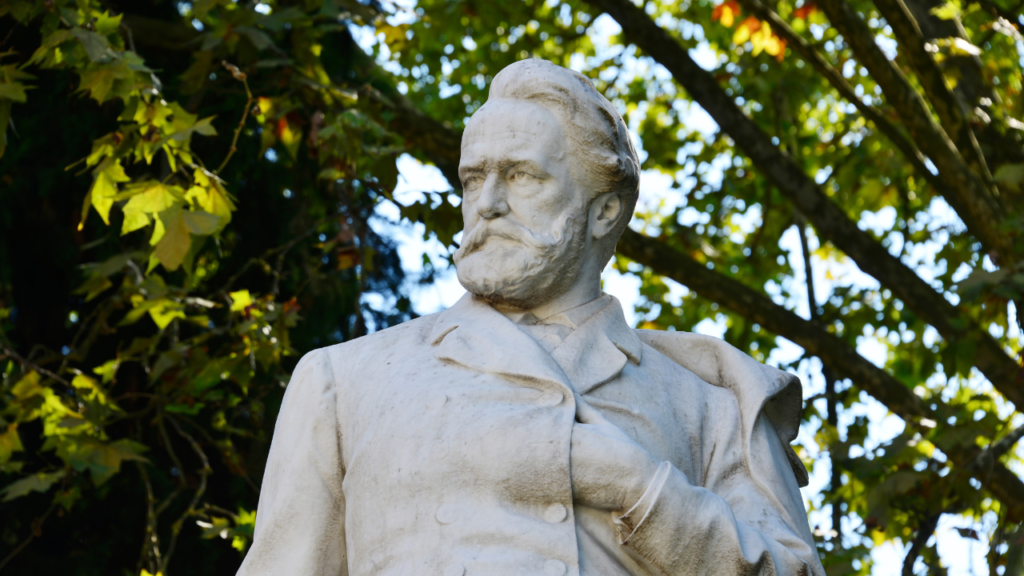
La méiose
Voici une figure de style quelque peu méconnue… et pour cause, puisqu’elle est « parente » de l’euphémisme et de la litote. Elle consiste à minorer ou déprécier quelque chose ou quelqu’un, et ce dans le but de valoriser autre chose ou quelqu’un d’autre. Exemples :
- Je n’ai pas fait grand-chose… Le mérite revient à mes collègues.
- J’étais effrayé : je n’ai fait qu’assister Jeanne, qui a aidé cette personne coincée dans sa voiture accidentée.
Les figures de style d’analogie
L’allégorie
C’est l’incarnation d’une idée abstraite au moyen d’un ou de plusieurs symboles. On rapproche des éléments pour trouver une idée commune, des ressemblances. Le temps, l’amour… peuvent faire l’objet d’une allégorie. Ce procédé est utilisé en littérature, mais également dans d’autres arts, notamment en peinture, en sculpture…
L’une des plus célèbres allégories est sans doute celle de la caverne, par le philosophe Platon. On en trouve d’autres : la justice est représentée sous la forme d’une femme aux yeux bandés, tenant dans ses mains un glaive et une balance. La mort prend souvent la forme d’un squelette tenant une faux… Les fables reposent très souvent sur une allégorie : chez La Fontaine, les animaux symbolisent des caractères humains.
Attention, il ne faut pas confondre l’allégorie et la personnification (voir plus bas), qui vise à donner un comportement spécifiquement humain à une chose non humaine.

L’animalisation
Il s’agit tout simplement de donner des caractéristiques animales à une personne ou à une chose. L’expression « brebis galeuse » est, à cet égard, une animalisation. Autres exemples : l’expression « gueuler » fait référence au loup, et un « requin de la finance » permet de parler d’un homme sans scrupules dans ce secteur d’activité.
La comparaison
Très présente en littérature et dans notre quotidien, la comparaison consiste à mettre en relation deux éléments qui partagent des similitudes. On utilise pour cela un comparatif (« comme », « de même que », « plus que », « moins que », etc.). Quelques exemples :
- Elle est aussi grande que lui.
- Napoléon est comme César : un militaire hors pair.
- Il est fier comme un paon !
La métaphore
Comme la comparaison, la métaphore consiste à rapprocher deux éléments afin de souligner leur point commun ou leur ressemblance. Cependant, contrairement à la comparaison, on n’utilise pas, dans la métaphore, d’outil de comparaison (« comme », « plus que »…). Basée sur l’analogie, la métaphore laisse deviner. Exemples :
- La vague des manifestants déferle dans les rues. On assimile ici les manifestants à la mer qui se déverse.
- Les ailes de la nuit s’étendent sur la plaine. La nuit est comparée à un oiseau qui déploie ses ailes.
Notez que la métaphore filée est une suite de métaphores sur le même thème. L’un des exemples le plus célèbres est sans doute ce passage de L’Expiation, poème de Victor Hugo, où l’auteur utilise à plusieurs reprises l’image de l’arbre.
La personnification
Attribuer des caractéristiques ou des propriétés humaines à une chose, un animal, un concept… voilà ce qu’est la personnification. Ainsi, si vous vous écriez : « Votre pays vous demande de prendre les armes ! », il s’agit d’une personnification. On notera que la personnification revêt bien souvent les habits de la métaphore.
Au fait, connaissez-vous les films dont le titre est une figure de style ?
Les figures de style d’amplification et d’insistance
L’accumulation
Il s’agit d’utiliser des mots ou groupes de mots de même nature ou de même fonction. Cela permet d’amplifier l’expression d’une idée ou la qualification d’une chose.
Exemples :
- Cet homme est bon, courtois, généreux avec son entourage.
- Cet arbitre est incompétent, incapable, nul !
Attention, il ne faut pas confondre cette figure de style et la gradation (voir plus bas) qui, elle, induit l’idée de progression dans l’énumération.
L’anaphore
Cette figure de style consiste à utiliser le même mot ou le même groupe de mots au début de phrases successives. Souvent employé en littérature, l’anaphore l’est aussi dans le langage courant et en politique. Le 2 mai 2012, lors du débat de l’entre-deux-tours qui l’opposait à Nicolas Sarkozy, François Hollande utilisa cette figure de style en répétant quinze fois : « Moi, Président de la République… » Nicolas Sarkozy répliqua en usant d’une autre figure de style : la répétition (« C’est une présidence partisane ? », une phrase prononcée à cinq reprises).

L’auxèse
Ne dites pas d’une personne sans-gêne qu’elle prend un peu trop ses « (aux)èses », ce serait une faute… Comme vu en introduction de cet article, l’auxèse est en effet une figure de style qui consiste à accumuler les hyperboles par le recours à la gradation. Edmond Rostand en use pour décrire le nez de son Cyrano, mais nous pouvons employer l’auxèse au quotidien : « Ce tableau est splendide, magnifique, somptueux ! »
L’énumération
Très simplement, l’énumération consiste à placer les uns à la suite des autres des mots ou des groupes de mots spécifiques, de même niveau syntaxique, afin de créer un effet d’ordre et d’exhaustivité. Exemple : « Voici les oignons, les navets, les pommes de terre, les poireaux, bref, tous les légumes de mon jardin. »
L’épanorthose
Encore un mot compliqué ! Que signifie-t-il donc ? Eh bien qu’on ajoute un élément à un autre déjà présent dans la phrase, car on le juge trop faible pour faire passer son idée. Objectif : rendre l’idée en question plus marquante ou atténuer son propos. L’épanorthose est une sorte de correction. Quelques exemples :
- J’espère… ou plutôt je suis certain qu’on vous écoutera !
- Il m’a blessé, je dirais même qu’il m’a presque assassiné !
La gradation
Il s’agit, comme vu plus haut, d’une forme d’énumération, mais avec un effet d’amplification. La gradation peut être ascendante ou descendante. Il y a souvent une progression vers l’idée finale. Corneille, dans Le Cid, fait dire à l’un de ses personnages : « Va, cours, vole et nous venge. » Un excellent exemple de gradation ascendante. Un exemple de gradation descendante, maintenant : « Il devenait petit, minuscule, microscopique ! » ou encore : « Face à la foule, il perdait ses moyens, se recroquevillait, se décomposait. »
L’hyperbole
On va, avec l’hyperbole, exagérer l’idée, le message ou le sentiment que l’on veut faire passer. « Je te l’ai déjà dit mille fois ! » est une hyperbole. On suppose en effet que, si la consigne a été répétée un certain nombre de fois, elle ne l’a pas été mille fois. Il y a de l’excès dans l’hyperbole. Autre exemple : « Ce lutteur est un véritable colosse ! »
Le pléonasme
Avec le pléonasme, vous redites, vous répétez, vous en rajoutez. Il s’agit en effet de renforcer une idée en lui adjoignant des compléments qui ne sont pas nécessaires au sens. « Le sang dans les veines » ou « je l’ai vu de mes yeux » constituent des pléonasmes. Attention : s’il n’est pas volontaire, le pléonasme devient erreur syntaxique. « Montez en haut » est un parfait exemple de pléonasme involontaire, ainsi que l’expression (fausse) « au jour d’aujourd’hui ».
La répétition
Répétez un mot, une expression ou un groupe de mots dans un texte… et vous obtenez une répétition, c’est aussi simple que cela. Il peut s’agir d’une maladresse. Mais, bien employée, la répétition est une figure de style des plus intéressantes, qui permet de marquer l’importance d’un élément. Exemple avec ce passage du roman Le Parfum de Patrick Süskind : « À l’époque dont nous parlons, il régnait dans les villes une puanteur à peine imaginable pour les modernes que nous sommes (…) Le paysan puait comme le prêtre, le compagnon tout comme l’épouse de son maître artisan, la noblesse puait du haut jusqu’en bas, et le roi lui-même puait, il puait comme un fauve, et la reine comme une vieille chèvre, été comme hiver. »
Les figures de style de construction
L’anacoluthe
Nous retrouvons ici le capitaine Haddock, puisqu’il s’agit de l’une de ses insultes (certes pas la plus utilisée dans les albums de Tintin).
L’anacoluthe désigne une rupture dans la construction syntaxique d’une phrase. Cela peut entraîner une incohérence ou une incompréhension. Elle peut être involontaire, notamment dans le langage parlé : il s’agit dans ce cas d’une faute, et on comprend mieux alors l’utilisation qu’en fait Haddock ! Mais, bien employée, elle crée un effet de surprise.
Exemple d’anacoluthe volontaire : “Le nez de Cléopâtre, s’il eût été plus court, la face du monde en eût été changée.” (Pensées de Pascal). On notera l’erreur syntaxique volontaire, mais aussi le lien entre “nez” et “face”.
L’aposiopèse
Que voici un mot compliqué ! Il s’agit pourtant d’une figure de style très simple, qui consiste à interrompre la phrase ou le discours pour mieux laisser suggérer la suite à qui lit ou écoute. Cela permet notamment de marquer un sentiment fort (amour, menace, etc.). Dans la version française du film Robin des bois prince des Voleurs, le shérif de Nottingham menace ainsi le père de Robin : « Soyez des nôtres, ou alors… » (vous en subirez les conséquences).
L’asyndète
Il faut comprendre ici : absence de liaison ! Oui, car l’asyndète est une figure de style bâtie sur l’absence de mot de liaison. Jules César n’a pas écrit : « Je suis venu, puis j’ai vu et enfin j’ai vaincu », mais « Je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu ». Il a utilisé (certes en latin…) une asyndète. Autre exemple : « Vous ne vous êtes pas exprimé quand il le fallait, ne vous plaignez pas ! » (on supprime là un « donc » dont la présence aurait pu se justifier).

La polysyndète
Cette figure de style consiste en une énumération de termes devant lesquels on placera la même conjonction de coordination, le plus souvent « et »… même si ce mot de liaison n’est pas indispensable. Ce procédé permet une mise en relief des différents éléments. Il s’oppose à l’asyndète, qui consiste justement à supprimer les mots de liaison. Exemple de polysyndète : « Mais tout dort, et l’armée, et les vents, et Neptune » (Iphigénie, Racine). Le « et » est répété.
L’hypotypose
L’hypotypose consiste en une description précise et imagée d’un moment de l’histoire. On propose ainsi de nombreux détails pour « donner vie » à la scène. L’idée est que le récepteur s’en fasse une idée précise. L’hypotypose est ainsi « une image », « une peinture », « un tableau ». Exemple : « Figurez-vous maintenant que le manège tournait lentement, alors même que tous les enfants en étaient descendus. Ses grands chevaux de bois bariolés montaient et descendaient. Ils semblaient montés par d’invisibles fantômes. Cela donnait une impression étrange et inquiétante. »
L’interrogation oratoire ou question rhétorique
C’est très simple : il s’agit d’une question qui n’attend pas de réponse, car celle-ci est donnée ou induite par celui qui la donne. Ce procédé est très employé en politique notamment. Il permet d’affirmer que le récit que l’on porte est le seul possible. Exemples :
- Dois-je laisser les comptes publics s’aggraver ? On imagine que la réponse logique ne peut être que « non ».
- Est-il possible de payer ces gens si peu ? La réponse morale est « non ».
Le parallélisme
Le parallélisme est une figure de style qui consiste à juxtaposer des éléments syntaxiques similaires. Il en résulte un effet de comparaison entre ces éléments. Exemples :
- Le premier était beau, le second était laid.
- Il s’y rendit en bus, elle y alla à pied.
On peut aussi évoquer ces vers d’un poème tiré des Fleurs du Mal (Baudelaire) : « Je suis la plaie et le couteau ! Je suis le soufflet et la joue ! »
Le truisme
Il s’agit d’une vérité si évidente que, probablement, elle ne mériterait pas d’être énoncée, mais certains auteurs en font une figure de style. Dans le film L’affaire est dans le sac, Jacques Prévert dit ainsi : « On ne fait jamais d’erreur sans se tromper. » Un très bel exemple de truisme !
Le zeugma
Un peu de technique maintenant… Le zeugma consiste à lier deux mots de sens et d’emploi différents autour d’un verbe unique, qui a la caractéristique d’être polysémique. Complexe définition, n’est-ce pas ? ? Mais cet exemple vous éclairera : « Il débarrassa la table et le plancher ». Le verbe « débarrasser » est ici employé dans deux sens différents. « Débarrasser la table » consiste à retirer tout ce qui s’y trouve, et « débarrasser le plancher » est une expression qui signifie s’en aller.
Les figures de style de sonorité
L’assonance
Cette figure de style consiste en la répétition de la même voyelle ou du même son vocalique dans des mots proches, ce qui produit une succession mélodieuse. Exemple : « J’avoue, j’en ai bavé, pas vous, mon amour… » (Serge Gainsbourg, La Javanaise). L’assonance repose sur le même principe que l’allitération qui, elle, désigne la répétition d’une même consonne dans une suite de mots. D’ailleurs, le précédent exemple est également une allitération : le « v » est plusieurs fois répété.
La paronomase
Avez-vous déjà rapproché les uns des autres des paronymes, des mots ayant des sens différents, mais des sonorités similaires ? Si oui, vous avez fait une paronomase : cette figure de style consiste justement à assembler ces termes proches par leur prononciation. Notez que cette figure de style est particulièrement adaptée aux proverbes. Par exemple : “Qui vivra verra”.
Autres exemples :
- « Horrible vie ! Horrible ville ! » (À une heure du matin, Baudelaire).
- « Il pleure dans mon cœur Comme il pleut sur la ville » (Il pleure dans mon cœur, Verlaine).
Les publicitaires sont eux aussi friands de ce procédé, qui permet de faire retenir plus facilement un message au public.
Découvrez les parcours Orthographe et Expression du Projet VoltaireLa polyptote
Peu connue, cette figure de style consiste à répéter un même mot sous plusieurs formes grammaticales. Ainsi, dans l’un des films de la saga Fantômas, le commissaire Juve – incarné par Louis de Funès – son adjoint et quelques témoins de la scène répètent plusieurs fois : « Je surgis, nous surgissons, vous surgissez, ils surgissent », créant ainsi une polyptote. Citons une polyptote plus célèbre, celle employée par le général de Gaulle dans son fameux discours : « La flamme de la résistance ne doit pas s’éteindre et ne s’éteindra pas. » Ou encore, Pierre Perret dans sa chanson Le cœur dans mon béret : « Je l’ai aimée, je l’aime, je l’aimerai… »
Notez que le mot « polyptote » est parfois considéré comme masculin et parfois féminin.
Les figures de style de substitution
La métonymie
La métonymie est une figure de style qui vise à substituer un terme à un autre, les deux étant « unis par une relation nécessaire » selon Le Robert (cause, effet, inclusion ressemblance…). Par exemple :
- « Lire un Stephen King » remplace « Lire un livre de Stephen King ».
- « Aller boire un verre » remplace « Aller boire le contenu d’un verre ».
Contrairement à la métaphore, le lien établi entre les deux éléments repose plutôt sur la logique que la similitude.
La parabole
La parabole est une forme d’allégorie. Élément rhétorique autant que stylistique – sinon davantage – elle est une courte histoire destinée à illustrer un enseignement. La parabole est très présente dans les textes religieux. Le récit du bon samaritain est un bon exemple de parabole. Il illustre un enseignement comme le font de nombreux contes et récits mythologiques.
La périphrase
La périphrase consiste à remplacer un élément par un autre. Elle « dit autrement », elle exprime de manière détournée, recherchant un effet de style. Si l’on parle des pays « qui vivent de l’or noir », on désigne ceux qui exportent du pétrole. Certaines périphrases sont devenues très communes : le Roi-Soleil, la Belle Province ou… faire ses besoins.
Exercice autour des figures de style
Saurez-vous reconnaître les figures de style qui se cachent dans les phrases ci-dessous ? Les réponses sont plus bas.
- « Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, Traversé çà et là par de brillants soleils » (Baudelaire, Les Fleurs du Mal)
- Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait ! (proverbe)
- « Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. » (Molière, L’Avare)
- Je meurs de faim ! (expression populaire)
- « L’Europe, qui vous hait, vous regarde en riant. » (Victor Hugo, Ruy Blas)
- « Mieux vaut s’enfoncer dans la nuit qu’un clou dans la fesse droite. » (Pierre Dac).
Réponses :
« Ma jeunesse ne fut qu’un ténébreux orage, Traversé çà et là par de brillants soleils. »
On peut d’abord noter la métaphore filée : la jeunesse est assimilée à un orage (donc une période tumultueuse) qui fut égayée de bons moments (les brillants soleils). Par ailleurs, la phrase prend la forme d’une antithèse, car elle rapproche deux éléments contradictoires : les orages ténébreux et les brillants soleils.
Si jeunesse savait, si vieillesse pouvait !
Peut-on considérer qu’il y a dans ce proverbe une double ellipse ? Probablement, car on pourrait parler de “la” jeunesse et de “la” vieillesse. On peut également voir dans cette phrase un parallélisme, car les deux parties se ressemblent et se répondent. Elles sont composées du même nombre de syllabes et sont construites selon un procédé syntaxique similaire.
« Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. »
Ainsi s’écrie Harpagon, le célèbre avare de Molière, lorsqu’il s’aperçoit que sa précieuse cassette pleine d’or lui a été dérobée. Ici, nous pensons que le doute est permis. Il peut s’agir d’une gradation, dans la mesure où chaque terme est “plus fort” que le précédent. Cependant, la structure syntaxique et le “final” en forme de paroxysme peuvent également suggérer une auxèse.
Je meurs de faim !
N’en rajoutez-vous pas un peu ? Vous ne mourez pas littéralement de faim. Vous avez juste très faim. Nous sommes typiquement dans le cas d’une hyperbole.
« L’Europe, qui vous hait, vous regarde en riant. »
Ruy Blas, dans son célèbre monologue, s’adresse aux grands d’Espagne au moyen de nombreuses figures de style… dont la personnification. L’Europe, pour le valet, se mue en une figure capable de détester et de rire… des caractéristiques bien humaines !
« Mieux vaut s’enfoncer dans la nuit qu’un clou dans la fesse droite. »
Oh le beau zeugma que voilà ! Pierre Dac joue ici sur le double sens de « s’enfoncer ». On peut s’enfoncer dans la nuit, au sens figuré. On peut également et techniquement s’enfoncer un clou dans la fesse, même si cela fait très mal !
Lisez aussi sur ce blog : comment améliorer son style d’écriture… et cet article sur l’haplologie.





